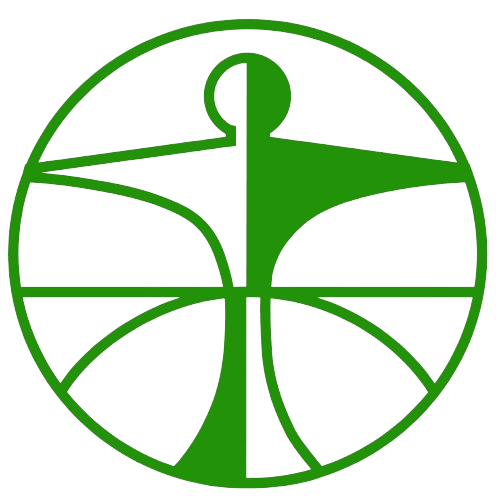DIRECTEUR DE L’INSTITUT DU FUTUR AFRICAIN, MEMBRE DU RAPPORT ALTERNATIF SUR L’AFRIQUE (RASA)
Samir Amin et la prospective en Afrique
enda Tiers monde : La prospective a commencé à se développer en Afrique dans les années 90, avec principal animateur feu Samir Amin. Que reste-t-il aujourd’hui de son travail ?
Alioune SALL «Paloma» : Je dirais que les années 90 ont correspondu à une relance de la prospective en Afrique, grâce notamment à un projet d’appui qui était basé à Abidjan, soutenu par le PNUD qui avait apporté son appui technique à une vingtaine de pays africains désireux d’explorer des avenirs possibles. Mais en réalité, la prospective a commencé beaucoup plus tôt en Afrique. D’abord, il faut savoir que le terme prospective est apparu en 1957. Pour la première fois, dans la littérature française, on a parlé de prospective sous la plume de Gaston Berger, un quarteron sénégalo- français. C’était dans une revue française qui s’appelle «La Revue des deux mondes». Dès 1960, il est repris en Afrique et un certain nombre de penseurs ont commencé à en parler. C’est le cas de Senghor, du Révérend-père Lebret et d’un certain nombre de personnalités comme Mohamed Diawara qui monta le Club de Dakar. C’était aussi le cas de Samir Amin.
Samir en parle d’abord lorsqu’il fait une brève incursion en Egypte après avoir fini ses études de science politique, de statistiques et d’économie. Mais il n’est pas resté longtemps dans ce pays à cause de la répression qui s’abattait sur les communistes. Mais déjà, à cette époque, il est parfaitement au courant de la prospective dans la réflexion sur le développement. Son intérêt se trouvera accru lorsqu’il séjournera au Mali et sera avec Seydou Bodian Kouyaté, entre autres personnalités, un des artisans penseurs de la planification du développement du Mali.
Au Sénégal, sous l’impulsion de Mamadou Dia, le premier plan de développement va explorer les perspectives de développement du Sénégal à l’horizon d’une décennie. Donc, dès les années 1960 et 62, il y a un travail d’exploration des perspectives de développement à long terme qui est mené au Sénégal. Il en va de même à cette époque-là en Côte d’ivoire, sous l’impulsion d’un certain nombre de penseurs africains mais aussi l’appui d’un Groupe tel que celui de l’IEDES (Ndlr : Institut d’études du développement de la Sorbonne) qui était basé à Paris dans lequel il y avait beaucoup de cadres qui avaient été formés au Commissariat au Plan français.
Donc disons qu’entre 1960 et 1980 il y a eu des initiatives majeures en matière de prospective et parmi les précurseurs figuraient déjà Samir Amin. Mais Samir aura été surtout celui qui, en 1976-1977, poussera le plus loin la réflexion prospective non pas sur un pays mais sur le continent et cela se fera à la faveur d’un projet qui s’appelait «Afrique et Problématique du futur», que Samir a dirigé entre 1977 et 1978. Il était un projet financé par l’UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) et Samir, en tant que directeur de ce projet, mènera un travail majeur de réflexion prospective sur le devenir du continent.
Qu’en sortira-t-il ?
Les résultats de ce travail seront présentés au Colloque de Monrovia qui se tint en 1979, alors que Tolbert est président en exercice de l’Organisation de l’Unité Africaine. Et c’est ce colloque de Monrovia qui dégagera un certain nombre de pistes autour desquelles va être élaboré le Plan d’action de Lagos. Donc, ce plan de Lagos qui va être approuvé en 1980 par les chefs d’Etats africains, doit énormément au travail qui a été fait sous l’égide de Samir. Tout cela pour dire que, quel que soit l’angle sous lequel on considère les choses, Samir est un des précurseurs en matière de réflexion prospective si on se réfère au fait que dès 1960 il est au courant des démarches prospectives et les applique dans le cadre de son travail aussi bien en Egypte qu’au Mali et plus tard au Sénégal à l’IDEP (Institut africain de développement économique et de planification).
Maintenant vous avez raison de dire qu’à partir de 1990 la prospective va connaitre un nouvel élan. Et là encore je dirais que Samir est quelque part à la manette, parce que non seulement il continuera ses réflexions sur le devenir du continent, mais il appuiera un certain nombre d’initiatives dont le but était de renforcer les capacités d’analyse prospective des pays et institutions africaines.
Je dois dire que j’ai personnellement bénéficié de l’appui de Samir lorsque, en 1997, j’ai dirigé le programme de réflexion sur l’Afrique soutenu par le PNUD. Et lorsqu’en 2002 j’ai monté l’Institut des Futurs Africains, j’ai également bénéficié du soutien de Samir qui a été membre de son Conseil d’administration dès sa création en 2003.
Samir Amin était marxiste. Cette orientation idéologique n’a-t-elle impacté son travail prospectif pour lui créer des barrières dans un continent où la plupart des Etats suivaient une orientation capitaliste ?
Samir Amin était marxiste mais le marxisme de Samir Amin était d’abord une exigence de rigueur scientifique. Ce n’était pas du dogmatisme, ni du psittacisme. Samir n’était pas de ceux qui allaient en récitant un bréviaire marxiste. C’était un homme exigent, soucieux de comprendre le monde et soucieux d’aller au-delà de l’écume des flots pour comprendre quels étaient les dynamiques qui donnaient forme au monde actuel tel qu’il se donnait à voir. C’était un analyste du réel. Être marxiste, pour lui, c’était d’abord cela. Et comprendre le monde, pour lui, signifiait comprendre les facteurs qui entrent en jeu dans la constitution de ce monde et les inter-relations qui existent entre les facteurs qui donnent forme à ce monde. Que ces facteurs soient d’ordre économique, sociale, politique, environnemental, culturel ou technologique. Samir a toujours consacré une grande partie de sa réflexion à comprendre quels étaient les facteurs qui ont façonné le réel dans lequel nous nous trouvons.
Mais ce n’était pas tout. Il fallait aussi comprendre qui sont les acteurs qui façonnent ce réel, parce que derrière chaque facteur il y a évidemment des acteurs. Les facteurs eux-mêmes ne font pas évoluer un système. C’est parce qu’il y a des acteurs qui sont derrières les facteurs que le système évolue. Et derrière les acteurs il y a toujours des stratégies. Un acteur n’a de l’influence sur un facteur que pour autant il est capable de mettre en œuvre une stratégie qui permet de contrôler les facteurs. Donc c’était cela pour Samir être un marxiste. Comprendre les facteurs en jeu dans l’évolution de nos sociétés, les acteurs qui sont derrière et les stratégies de ces acteurs. Et quand on fait un tel travail, il est évident qu’on ne peut pas ne pas tomber sur le fait qu’un des acteurs majeur de l’évolution se trouve être le système capitaliste mondial.
C’est un système essentiellement basé sur l’accaparement…
Ce système capitaliste développe des stratégies qui lui permettent d’avoir un monopole sur un certain nombre de facteurs clés qui sont jugés importants pour élargir la domination de ce système capitaliste mondial, permettre son expansion et son approfondissement, et c’est dans ce cadre que Samir Amin s’est livré à une analyse des systèmes capitalistes mondiaux parce que ce système, encore une fois, est un acteur majeur de la transformation de notre monde. Il a donné forme à notre monde actuel et notamment à cette intégration qui fait que l’enrichissement des uns ne peut se faire qu’au prix de l’appauvrissement d’autres. Le développement du sous-développement est la condition pour la perpétuation de ce système capitaliste mondial dont il a fait une critique très serrée.
Je crois donc que c’était donc cela être marxiste pour Samir. Il se trouve que c’était également une exigence pour toutes les prospectivistes. Tous, commencent lorsqu’ils doivent faire un travail d’analyse prospective, par un diagnostic stratégique du système qu’ils veulent analyser et le diagnostic stratégique n’est rien d’autre que l’analyse des facteurs qui entrent dans la composition du système que l’on étudie, l’analyse des inter-relations entre ces différents facteurs, l’analyse des acteurs et les stratégies d’acteurs.
Si Samir Amin a pu malgré tout procéder à ce travail d’analyse, ses idées ont-elles impacté le continent ?
Samir était un analyste rigoureux, scientifique. C’était aussi un acteur. Il n’était pas soucieux exclusivement d’expliquer le monde, il était soucieux de le transformer. A-t-il eu de l’influence ou pas ? Ce sera à l’histoire de le dire. Mais ce qui est sûr, c’est qu’un certain nombre d’idées qu’il a défendues et qui paraissaient radicales au moment où il les a défendues ont aujourd’hui acquis droit de cité. Lorsqu’il propose une analyse du sous-développement différente de celle qui avait court à l’époque où l’on pensait qu’il y avait deux mondes qui évoluaient de façon parallèle, un monde développé et un monde sous-développé, et qu’il montre qu’en réalité il y a un processus d’accumulation à l’échelle mondiale qui fait qu’il existe aujourd’hui des périphéries et des centres qui sont en partie lié (la périphérie étant un produit du centre et le centre se nourrissant du sous-développement de la périphérie), il est clair que lorsqu’il développe de telles idées – il n’est pas le seul d’ailleurs à le faire – il passe un hétérodoxe, un radical.
Mais ces idées-là ont aujourd’hui acquis droit de cité. Nul ne les conteste plus. Personne ne peut revenir aux analyses des années 40 sur le phénomène du sous-développement. Donc de ce point de vue là, je dirais que sa réflexion a eu un impact sur l’évolution des idées.
Maintenant, sans doute, Samir avait-il souhaité ou espéré que le monde serait transformé et qu’il verrait un monde plus humain devenir réalité, un monde ou régnerait la paix, la justice, un système de production moins écocide, plus responsable, un monde où le partenariat remplacerait la compétition, etc. Sans doute ce monde-là il en a rêvé. Qu’il ne l’ait pas vu de son vivant n’a pas dû le surprendre non plus outre mesure. Car s’il y avait quelqu’un d’assez réaliste pour comprendre que le grand soir n’arriverait pas du jour au lendemain c’était bien Samir. Mais au fond qu’est-ce qu’une vie humaine au regard de l’histoire ? Je suis sûr que ce n’est pas grand-chose.
Qu’est-ce qui reste du travail de Samir Amin ?
Ben… Beaucoup à mon avis. D’abord Samir a mis sur pied ou a aidé à ce que se mette sur pied ou que se renforce un certain nombre d’institutions. Parmi elles l’Université de Dakar où il a servi, à la Faculté des Sciences économiques. Il y a l’IDEP dont il a quand même marqué la trajectoire et en a fait une institution de référence à un moment où elle était un modeste centre de formation pour quelques planificateurs. Samir a été aussi à la base ou a appuyé la création d’une institution comme ENDA. Mois j’ai connu personnellement ENDA à l’époque où c’était un cours au sein de l’IDEP consacré à Environnement et Développement en Afrique et où il y avait deux, trois professionnels dont Jacques Bugnicourt et Philippe Langley et un zimbabwéen qui s’appelait Libertime Mhlanga. C’est ce cours qui s’est transformé pour devenir l’organisation non gouvernemental internationale ENDA.
Samir a été donc un fervent soutien à la création d’ENDA et il a fait équipe avec Bugnicourt pour s’assurer que l’organisation bénéficierait de tout le soutien possible au Sénégal et ailleurs. Samir a été un des artisans à la base du CODESRIA et en a été le premier secrétaire général. Samir, on va le retrouver au Forum du Tiers Monde et on le retrouvera au Forum Social Mondial. Fort heureusement toutes les institutions que j’ai citées continuent d’exister et on peut penser que le legs de Samir Amin est encore là. Sa pensée fait l’objet des discussions au sein de ces institutions et je crois qu’on peut dire qu’il reste quelque chose. Dans les centres de recherche, dans les universités mais aussi dans les formations politiques, les ONG et dans les mouvements de masse il y a plusieurs canaux de diffusion de la pensée de Samir Amin qui font que celle-ci est encore vivante, vivace et continue d’inspirer.
Mais peut-on en dire de même au niveau étatique ?
Je pense qu’au niveau des Etats, le bilan serait beaucoup plus mitigé. Samir a eu quelques entrées auprès d’un certain nombre de chefs d’Etats, comme au Mali où il a séjourné dans les années 60 après son passage en Egypte. Je pense qu’il a aussi, à un certain moment, un conseiller écouté au Congo Brazzaville. Il a sans doute eu des entrées ou une certaine influence dans les cercles décisionnels au Burkina à l’époque de Thomas Sankara. Je pense qu’à un moment également Senghor lui a prêté attention lorsqu’il a découvert la détérioration des termes de l’échange et en a fait son cheval de bataille. Donc il n’a pas été totalement absent dans les réflexions sur la planification du développement.
Maintenant il est certain que il ne pouvait pas avoir une très très grande influence en Afrique, parce que l’économie politique africaine est dominé dans beaucoup de pays par les institutions de Bretton Woods et ces institutions se sont spécialisées dans les prophéties autoréalisatrices. Cela veut dire que pour avoir accès à des chefs d’Etats aujourd’hui, il faut commencer par démonter les carcans intellectuels dans lesquels les enferment ces institutions de Bretton Woods. C’est un travail titanesque que de chercher à avoir aujourd’hui une influence auprès de certains chefs d’Etats africains.
Au vu des contraintes institutionnelles que vous évoquez n’est-il pas difficile de faire de la prospective en Afrique ?
Le travail de prospective n’est facile nulle part. Ni en Afrique, ni ailleurs. Il n’est pas facile pour une raison intrinsèque qui tient à ce que la prospective n’est pas. Il y a une grande confusion autour de ce qu’est la prospective. Ce n’est pas de la prophétie qui relève de la théologie. La prospective n’est pas non plus de la prédiction parce que la prédiction est univoque. On affirme que telle chose va se passer à telle date. La prospective n’est pas la planification, qui est le dessin d’un projet. Ce n’est pas non plus de la programmation, qui est la mobilisation des moyens pour mettre en œuvre un plan. La prospective n’est rien de tout cela. Et cela rend l’exercice de réflexion prospective difficile partout. Ça l’est encore plus en Afrique, pour des raisons que je viens d’évoquer.
Pouvez-vous y revenir ?
C’est que l’Afrique est traitée par beaucoup, singulièrement par les institutions de Bretton Woods, comme une espèce de feuille blanche sur laquelle on peut tirer des plans, tracer des épures, prendre des décisions, etc. Et sans qu’on ne le sache, coloniser le futur de l’Afrique, considérer que l’Afrique a vocation à faire ceci ou cela, qu’elle a vocation à émerger, à être dans un marché mondial… Et malheureusement, les dirigeants africains (beaucoup d’entre eux) ont tellement adhéré à ces discours qu’ils n’ont pas l’esprit critique nécessaire pour se libérer de ces discours qui en réalité les enferment dans des rôles subalternes. Et ces dirigeants finissent par croire, comme aimait à le dire Margaret Tatcher (Ndlr : ancienne Premier ministre de Grande Bretagne), qu’il n’y a pas d’alternatives au modèle de développement dominant. Et dès lors qu’on accepte cela, on accepte aussi l’idée selon laquelle c’est le passé des autres qui va nous servir de futur. Nous devons, pour nous développer, suivre les trajectoires qui ont été celle des pays dit développé.
Il est clair que lorsqu’on adopte une telle attitude mentale, il n’y a plus de place pour une réflexion prospective Parce que le vrai but de la réflexion prospective c’est de s’intéresser aux avenirs possibles et aux ruptures qui vont rendre ces avenirs possibles. Mais lorsqu’on est incapable de penser une rupture, lorsqu’on est incapable de prendre du recul par rapport au réel, la réflexion prospective n’a plus d’aisance. C’est pour cela que la réflexion prospective est difficile en Afrique.
Ceci étant dit, aurait-on pu prévoir, par exemple, l’ampleur des migrations africaines aujourd’hui ?
Les migrations ne sont pas un phénomène qui surprend les prospectivistes. Pour deux raisons. La première c’est que les migrations font partie de l’histoire de la condition humaine. Depuis les premières migrations qui ont été étudiées et analysées (elles remontent à Uhr et à Chaldée), on n’a jamais pu arrêter les phénomènes migratoires. Les deux seules exceptions que l’on connaisse sont liées à la Révolution culturelle (ndlr : en Chine), période à laquelle on a assisté à un retour vers les campagnes d’un certain nombre de citadins, souvent d’ailleurs sous la contrainte.
L’autre exemple a été le Cambodge sous le règne de Pol Pot où, effectivement, on a renvoyé là aussi vers les campagnes un certain nombre de citadins, beaucoup d’intellectuels, pour soi-disant les rééduquer. Mais exception faite de ces deux périodes qui sont quand même de triste mémoire dans l’histoire de l’humanité, les migrations vers les agglomérations ont toujours existé. Rien ne permet de penser que ça va s’arrêter. C’est donc une des premières raisons qui font que les phénomènes migratoires n’ont pas surpris les prospectivistes.
Il y a une deuxième raison pour laquelle ce phénomène n’a rien de surprenant pour les prospectivistes. C’est que, au fond, les discours des fondamentalistes du marché (comme Samir Amin appelait les penseurs néolibéraux), tournent autour de la libre circulation. Mais quand on veux vivre la libre circulation, on ne peut pas arrêter les phénomènes migratoires. Pour la simple raison qu’on ne peut pas vouloir la circulation des biens, des capitaux, des marchandises, des idées et vouloir en même temps limiter la circulation des personnes et on veut des produits mais on ne veut pas de ceux qui sont à la base des produits. On veut restreindre la liberté de mouvement des personnes, mais on est intéressé à ce que ces mêmes personnes s’ouvrent aux marchés internationaux, ne ferment pas leurs frontières, produisent des idées, etc.
Les migrations obéissent à une marche de l’histoire, certes, mais est-ce qu’on pouvait prévoir, il y a cinquante ans, l’ampleur que cela prend aujourd’hui ?
L’ampleur, c’est discutable. Peut-être que personne ne pouvait prévoir l’ampleur du phénomène. Mais que le phénomène soit un élément qui allait participer à façonner le monde, cela était déjà entrevue et analysé. Personne ne pouvait penser non plus qu’il aurait un tel retour à la barbarie et à des mesures aussi répressives que celles qui ont été prises dans les pays du nord pour freiner ce qu’ils considèrent comme étant l’arrivée de hordes qui pouvait mettre en péril le bonheur, le bien-être des civilisations prospères occidentales.
Y a-t-il d’autres scénarios aussi marquants auxquels on pourrait penser par rapport à l’avenir du continent ?
Il y a quatre scenarios qui sont d’une très grande plausibilité et qu’on ne peut donc pas écarter lorsqu’on réfléchit au devenir de l’Afrique. Un premier scénario est celui dans lequel, au fond, il n’y aurait pas de développement en tant que tel. En tout cas pas de développement durable. Un tel scenario est un scenario qu’on peut appeler tendanciel, parce qu’il s’inscrit dans le prolongement des tendances observées au cours des soixante dernières années d’indépendance. Aucun de nos pays, pas même le Nigeria ou même l’Afrique du Sud, ne s’est transformé structurellement au point de mériter l’appellation de pays émergent si on est strict dans la définition. Mais il n’y a pas non plus les catastrophes qui étaient annoncés dans les années 60 ou tout le monde criait que l’Afrique était mal partie, que le continent allait se désintégrer. Ce n’est pas le cas ; il ne s’est pas désintégré, il existe, il fonctionne avec ces contradictions, il ne s’est pas développé comme cela était souhaitable mais grâce à des aides alimentaires lorsque des récoltes sont déficitaires, grâce à des aides budgétaires lorsqu’il faut payer les fonctionnaires, grâce à des aides militaires, etc., le continent ne fonctionne qu’à un quart. C’est un scénario dont la continuation est plausible même si cela va être difficile.
Un deuxième scenario tout à fait plausible est, au contraire, un scenario d’entropie. Si, pour une raison ou pour une autre les aides budgétaires venaient à tarir, si les aides alimentaires venaient à se faire rares, si les assistances militaires venaient à être difficiles, il est certain qu’un certain nombre d’Etat dont on dit aujourd’hui qu’ils ont failli ou qu’ils sont faibles, ne tiendrait pas le coup pendant très longtemps. Et on pourrait voir se développer des friches étatiques à l’intérieur des pays, des zones désertées par l’Etat. Une extension de ces zones pourraient transformer certaines régions en régions de non droit et on a évoqué à ce propos le Sahel comme un théâtre possible d’une régression de pic anthropique ou l’Etat s’effondrerait et certains chercheurs ont donné à ce scénario le nom de «Sahelistan», en référence à l’Afghanistan. Un «Sahelistan» dont l’épicentre serait le Mali qui, dans ce scénario, n’irait pas sans rappeler la Somalie actuelle. C’est un scenario doté d’une certaine plausibilité et donc il faut l’avoir à l’esprit.
Et les deux derniers scénarii ?
Le troisième scénario qui n’est pas impossible même s’il est difficile, c’est un scénario dans lequel certains pays africains arriveraient à réussir leur processus d’émergence. L’émergence est dans toutes les bouches qui doivent s’exprimer en français. Aujourd’hui tout le monde prétend émerger, tout le monde veut l’émergence. Ce n’est pas impossible si on mesure l’émergence par un certain type d’intégration au marché mondiale. Il n’est pas impossible que certains pays arrivent à faire ce qui a été fait en Asie, en Amérique latine, etc. Un accroissement de la productivité, la prédominance d’une rationalité de type économique par rapport à des logiques relationnelles, etc. Ce n’est pas impossible. Ce ne sera pas le cas de tous les pays africains, mais quelques-uns peuvent l’être. C’est le cas d’un pays comme le Nigeria s’il était mieux gouverné, comme l’Afrique du Sud si les disparités n’étaient pas aussi criantes qu’elle le sont aujourd’hui, ou un pays comme le Kenya, etc. Ce sont des pays potentiellement émergents.
Le quatrième scenario n’existe nulle part dans le monde. Ni en Afrique ni en Amérique latine, ni en Asie ni en Europe. Ce serait celui d’une transformation radicale des économies et des sociétés pour asseoir les bases d’un véritable développement durable et d’une croissance inclusive. C’est à dire que ce serait le triomphe d’un modèle qui concilierait croissance et justice, considération environnementale et préoccupation de satisfaction des besoins du plus grand nombre grâce à une croissance soutenue. Un tel modèle n’existe nulle part. Mais ce n’est pas parce qu’il n’existe pas qu’il n’est pas possible ou même plausible. Donc je dirais qu’il y a quatre scenarios qui sont plausibles aujourd’hui mais leur degré de plausibilité est différent d’un pays à un autre, d’une région à une autre.
Leur réalisation peut s’avérer difficile mais pas impossible.
Finalement la prospective, en Afrique, pour être féconde, devrait reposer sur des systèmes qui osent rompre avec les institutions de Bretton Woods et promouvoir un développement plus endogène ?
Je crois que les institutions de Bretton Woods sont fidèles à leur vocation qui est d’être les gendarmes du système capitaliste mondial. Donc leur vision de l’avenir et leur démarche en matière de gestion du développement sont conformes à leur mission. Ces institutions veillent à ce que les marchés fonctionnent au profit des oligarchies qui dominent ces marchés. Toutes leurs propositions ou leur regard sur le monde se fait à travers ce prisme. A travers cette idée selon laquelle c’est le marché qui doit guider le monde et que la logique marchande est la seule qui vaille. Il est clair que cette façon de voir ne peut que mener aux catastrophes que l’on connait aujourd’hui. A savoir une destruction de l’environnement, une fragilisation du tissu social du fait de l’effritement des solidarités et une menace à la survie de la planète parce qu’il y a une surconsommation des ressources environnementales.
Il ne faut certainement pas, lorsqu’on est soucieux de durabilité, se référer à cette logique. Il faut partir d’une autre logique qui consiste à dire qu’au fond nous n’avons qu’une planète et nous devons faire en sorte qu’elle soit exploitée au mieux, de façon à satisfaire aux besoins du plus grand et de façon à ne pas non plus compromettre l’avenir des générations à qui nous empruntons ce capital dont nous ne sommes pas véritablement propriétaire. C’est donc à un renversement total des perspectives qu’il faut procéder.
C’est peut-être cela que vous appelez une vision du développement plus endogène. Si c’est cela, oui je suis d’accord avec vous. Il faut inverser les perspectives, il faut partir des besoins des communautés de base, des besoins des groupes, des communautés et non des besoins du marché.
L’Afrique, le monde, fait face à la Covid. Comment voyez-vous son avenir ?
Je crois que la Covid a pris tout le monde de court. On n’a pas fini d’analyser ce qu’est la Covid, mais on peut dire que c’est probablement la première crise globale au sens ou non seulement elle a touché toutes les régions du monde. Elle est inédite aussi par les conséquences qu’elle a eu dans divers domaines. Ce n’est pas simplement une crise qui a affecté des systèmes sanitaires et mis à rude épreuve leur capacité, c’est une crise qui a affecté la gouvernance des sociétés. On a vu des restrictions aux libertés qui ont été apportées sous prétexte de nécessité de juguler la crise sanitaire. Les économies ont été mises à l’arrêt et on assiste à des chutes phénoménales du Pib sur tout le continent. Il y a même des conséquences sur le plan culturel, puisqu’à force d’ordre et de contre ordre les prétendus sachants et savants ont créé le désordre et semé le doute dans les esprits. Aujourd’hui on confine demain on ne confine pas, aujourd’hui le port du masque est obligatoire demain ça ne l’est pas. Aujourd’hui la quarantaine est obligatoire demain on trouvera que cela n’est pas nécessaire.
Il y a eu des affirmations aussi péremptoires dans leur énoncé que peu fiables sur le plan des fondements scientifiques. Et cela a été une source d’angoisse culturelle et les gens se demandent s’il faut croire à la science désormais parce qu’on a entendu tout et son contraire. Donc la Covid, à mon avis, rentre dans la catégorie de ce que Jacques Attali appelle des «peurs structurantes». Il y a des moments dans la vie des sociétés où de tel phénomènes se produisent et quand ils se produisent le regard que l’on jette sur soi, sur son passé et sur son avenir change forcement. Le futur ne sera plus ce qu’il était parce qu’entretemps il y a eu la Covid qui a montré un certain nombre de faiblesses, qui a montré l’inanité d’un certain nombre de projet. Donc je crois que c’est un moment important dans l’histoire. Il y aura bien un avant et un après Covid.
En Afrique, on sent tout de même que cela bouge positivement…
Oui, j’observe également que Covid a été l’occasion pour l’Afrique d’expérimenter in situ, pratiquement, le fait qu’il n’y a pas de fatalité historique. Au début de la pandémie, tout le monde a pensé que l’Afrique serait la victime idéale de cette pandémie. Tout le monde, à commencer par le Secrétaire général des Nations Unis, prédisait des millions de morts. Le directeur général de l’OMS, qui est Africain, appelait aussi l’Afrique à s’éveiller en mettant en exergue le risque d’une létalité très forte associée à la Covid. Mais il n’en a rien été. L’Afrique, aujourd’hui, c’est trente-cinq mille morts. C’est le chiffre de l’Italie qui, seule, compte plus de morts.
L’hécatombe macabre qui risquait d’être le filon pour certaines organisations internationales ne s’est pas produit. Cela prouve encore une fois que les prétendus sachants ne sont pas toujours les mieux indiqués pour donner la bonne information. Mais ce qui est encore plus intéressant à remarquer c’est que l’Afrique ne doit pas son salut à des forces extérieures. Elle le doit à ses propres forces. Personne n’est venu sauver les Africains. Ils se sont sauvés eux-mêmes. Alors est-ce leur climat ? Leur gêne ? S’agit-il d’autres choses ? Toujours est-il qu’aucun pays soit disant donateur ne peut revendiquer ou s’octroyer le bénéfice de la situation africaine. Je crois donc que cela devrait être une source d’encouragement des Africains à oser se prendre en charge puisque les autres n’ont pas de solutions. Ni pour eux ni pour l’Afrique et que les solutions africaines, volontaires ou pas, semblent marcher.
Je crois que l’heure n’est plus aux doutes. Le scepticisme ou l’afro-scepticisme qui emmenait certains à se demander si les Africains vont sauver l’Afrique n’a plus de raison d’être. La réponse est claire aujourd’hui : c’est aux Africains de se sauver eux-mêmes. Et j’ajouterai que les Africains ont les moyens de le faire. Si l’on sort de cette crise avec un tel état d’esprit, la Covid aura été utile. Mais il faut aussi tirer toutes les leçons de la Covid et notamment pallier les faiblesses que la Covid aura mis en exergue. Il y en a beaucoup, à commencer par la faiblesse de nos systèmes sanitaires et au-delà de nos systèmes sanitaires, de nos systèmes de protection sociale.
Peut-on imaginer, dans le chaos qui se dessine, le Sud redevenir le centre du monde ?
Je ne le souhaite pas. Parce qu’au fond, devenir maitre et être enfermé dans la dialectique du maitre et de l’esclave ne me semble pas être quelque chose de particulièrement excitant. Je veux d’un monde sans maitre, sans esclave. Donc je ne souhaite pas être le maitre tout comme je ne souhaite pas être l’esclave. Une inversion des rôles ne me satisferait pas. Je pense, par contre, que rééquilibrer les relations entre le Nord et le Sud dans le cadre d’une division du travail qui soit moins inégalitaire, dans un partenariat véritable entre communautés, entre nations, je crois que c’est tout à fait souhaitable. Parce que, encore une fois, nous n’avons qu’une planète et il nous faut trouver les moyens de vivre ensemble, d’organiser un vivre ensemble sur une planète. Car si nous la détruisons nous sommes tous partis pour échouer.